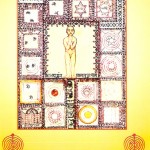 Dans la précédente parution, nous avons commencé à nous pencher sur le tout début des Yoga Sûtra, et particulièrement sur cinq « mouvements » du mental qui occultent, comme toutes les autres activités mentales ordinaires, une énergie de vision, DRASHTAR, le Témoin, qui, au cœur de notre espace intérieur, est pure clarté et liberté. Ces « mouvements » peuvent être, pour Patanjali, à l’origine de bien des souffrances intérieures, mais pas systématiquement.
Dans la précédente parution, nous avons commencé à nous pencher sur le tout début des Yoga Sûtra, et particulièrement sur cinq « mouvements » du mental qui occultent, comme toutes les autres activités mentales ordinaires, une énergie de vision, DRASHTAR, le Témoin, qui, au cœur de notre espace intérieur, est pure clarté et liberté. Ces « mouvements » peuvent être, pour Patanjali, à l’origine de bien des souffrances intérieures, mais pas systématiquement.Nous avons abordé les trois premiers : PRAMÂNA, le mode de connaissance adéquat, VIPARYAYA, l’erreur, et VIKALPA, l’imagination.
Continuons donc avec deux autres composantes majeures de notre intériorité : NIDRÂ et SMRITI.
NIDRÂ
(I, 10) « abhâva pratyaya âlambanâ vrittir nidrâ » : Le sommeil avec rêves s’appuie sur une expérience mentale fictive (sans substance)
NIDRÂ = sommeil, somnolence
VRITTIR NIDRÂ = sommeil en mouvement, agité, donc avec rêves
Nous voilà à présent face à un fonctionnement du mental qui se caractérise par l’absence totale de maîtrise et par un état de non conscience, notions antinomiques avec la Pleine Conscience et avec la pure énergie de Voir.
Si nous envisageons NIDRÂ dans son acception de « somnolence », cela va concerner des états léthargiques, des moments d’endormissement, de rêvasseries éveillées, qui peuvent surgir quand nous sommes fatigués ou bien dans l’obligation de lire ou d’écouter des textes ou discours extrêmement fastidieux. Il va y avoir alors suspension des agitations du mental, mais par lourdeur « tamasique »(1), prélude à une plongée dans le sommeil. Il y a comme une asphyxie mentale qui nous installe bien loin de la lucidité requise pour une claire vision. Au cours de notre pratique, dans des postures où nous nous trouvons dans un grand confort et pendant les assises silencieuses, une vague somnolence rêveuse peut nous envahir. Et, si nous ne cultivons pas en permanence une acuité vigilante, nous pouvons prendre pour un état méditatif ce qui n’est qu’un simple assoupissement bienheureux.
Mais le yoga a trouvé le moyen d’utiliser ces états de somnolence et de les canaliser dans de riches explorations. C’est la pratique de YOGA NIDRÂ, le sommeil « relié ».
En installant un calme physique profond, ces techniques vont utiliser le moment où le mental a lâché son activité ordinaire, juste quand il n’a pas encore basculé dans le sommeil, et quand il est encore conscient. Mais au lieu de laisser libre cours à d’obscures et anarchiques rêveries, on va le guider dans des parcours intérieurs qui vont renforcer la cohésion et les équilibres médullaires de l’individu.
Comme pour les méditations guidées, au cours de ces « rêves éveillés », on va aussi jouer avec l’évocation d’images et de situations qui vont nous relier aux équilibres et aux forces profondes de l’univers.
Ainsi, ce qui aurait pu être un écueil de l’esprit devient un outil de transformation.
Mais NIDRÂ signifie aussi le sommeil. Là, Patanjali parle du sommeil avec rêves (VRITTIR NIDRÂ), car le sommeil profond se caractérise par une absence quasi totale d’activité psychique. Il peut paraître surprenant d’introduire le sommeil et les rêves dans les composantes du mental, puisque leur champ est, dans la léthargie du sommeil, totalement envahi par l’inconscient. Le sommeil va ouvrir les portes à ce que nous gardons enfoui au plus profond, à ce que nous n’avons pas résolu, à des structures plus ou moins pathogènes dans lesquelles nous nous sommes, au cours de notre histoire, installés. Tout cela va surgir sans aucune retenue, et nous serons les acteurs passifs de scenarii aux images simples ou complexes, douces ou fortes, agréables ou douloureuses, terrifiantes ou jouissives. Dans les rêves, nous vivons des vies parallèles où tout, absolument tout, est possible. Tout cela forme un langage magnifiquement structuré, à l’imaginaire débridé. La non maîtrise est absolue, l’expérience est fictive, mais c’est un langage.
Et surtout, ce champ de l’inconscient est un lieu de vérité. Le rêve dit ce qui est, mais avec d’autres « mots », d’autres codes que ceux que nous utilisons en état de veille. Il n’est pas linéaire et est composé de plusieurs strates, avec un contenu apparent et des contenus plus secrets. D’où toutes les difficultés de décryptage et d’interprétation de cette parole.
Tout le monde perçoit qu’il y a des leçons à tirer du monde de nos rêves. Chaque rêve est là pour nous apprendre quelque chose. Quelque chose qui n’a pas encore émergé à la conscience de veille, et ce à tous les niveaux : des résolutions les plus banales et quotidiennes jusqu’aux leçons des rêves-pouvoirs, des rêves-enseignements spirituels, en passant, bien sûr, par la compréhension de refoulements anciens.
L’outil psychanalytique, formidable apport aux sciences cognitives, nous fait prendre conscience de nos ressorts les plus profonds. Nous ne pouvons nier le rôle majeur de cette formidable énergie désirante, l’énergie vitale que l’on appelle la libido, énergie gérée par SVÂDISHTHANA (« fondement de l’individu, de soi »), énergie qui préside à toutes les gestations et à toutes les créations. Et ce n’est pas déroger à notre statut de chercheur de l’intériorité ni à notre spiritualité, que de savoir déceler en nous son impact, le comprendre et le gérer intelligemment. Le déni conforterait nos refoulements et nous installerait dans des déséquilibres et des cristallisations pathogènes.
Les rêves et leur parfum continuent bien souvent à imprégner notre vie diurne. Ce qui fait que, la plupart du temps, nous rêvons notre vie au lieu de la vivre en toute lucidité et liberté. En cela, ils contribuent aussi au brouillage général du mental.
L’observation attentive, claire, en détachement passionnel, qui est l’apanage de notre pratique de yoga, va, autant que faire se peut, nous permettre d’aborder nos rêves de la même façon que les postures, en compréhension de leurs résonances profondes. Nous abordons les expériences posturales difficiles sans les nier ni prendre la fuite. Alors, sans en avoir peur, affronter le souterrain, l’obscur, « la boue et les épines » (cf. Y.S. III,40) qui remontent à travers les rêves, va nous permettre, en les amenant à la lumière de la connaissance, de voir comment nous sommes structurés dans nos pulsions, dans nos désirs inavoués et dans notre refoulé. Tout ce qui vient à un niveau conscient, abordé sans accablement ni culpabilité, permet de mettre en place des analyses (VICHÂRA) qui, avec l’aide de l’intelligence de discernement (VIVEKA), nous permettra de faire un nettoyage salutaire. Plus tard, dans ce même chapitre, Patanjali, donnant des pistes pour éradiquer les diverses sources de tourment, nous dira, entre autres :
(I,38) « (la stabilité du mental s’obtient) en s’appuyant sur la connaissance du sommeil et des rêves »
Certains enseignements traditionnels, et particulièrement les tibétains, ont développé de complexes techniques de maîtrise des rêves et du sommeil profond.
Partant du principe que si nous arrivons à vivre notre vie diurne en pleine conscience, cette même conscience doit aussi éclairer notre vie nocturne et ce champ réfractaire à toute lucidité que sont les rêves. Ainsi, nous engagerons-nous avec la totalité de notre individu dans un vécu de plénitude. Et au moment du grand passage de vie à trépas, cette claire conscience, sans aucune rupture, nous permettra d’aller vers la lumière.
Cette recherche et ces techniques forment ce qu’on pourrait appeler le degré ultime du YOGA NIDRÂ.
Le sommeil offre un moment de repos et de rééquilibrage pour le corps physique.
Tout aussi indispensable est la fonction du rêve.
Les rêves sont une respiration pour notre psychisme, une soupape de sécurité pour éviter les saturations dues aux désirs inconscients et aux conflits non résolus.
Quelquefois, les rêves apportent des réponses à des questionnements immédiats apparemment insolubles.
Mais surtout, les poussées pulsionnelles de l’inconscient, modifiées par une fonction censurante, affaiblie mais pas supprimée, s’y théâtralisent en véritable catharsis. Et ce avec d’autant plus d’intensité et de force que le conflit est important. Ainsi, plus le rêve sera intense et marquant, plus il y aura une petite chance pour que notre conscience de veille soit interpellée et en prenne acte.
Tout cela va contribuer à forger peu à peu un équilibre intérieur général.
Et enfin, n’oublions pas que sans le sommeil et sans les rêves, la mort nous guette plus vite que sans nourriture.
Mais, si nos rêves sont si prégnants, c’est qu’ils sont nourris par la mémoire.
Et nous voilà dans cette cinquième composante dont nous parle Patanjali, SMRITI, la mémoire.
SMRITI
(I, 11) « anubhûta vishaya asampramoshah smritih » : La mémoire (c’est) retenir (ne pas perdre) le champ des expériences.
SMRITI, c’est ne pas oublier les expériences passées, mais surtout leur « champ », c’est-à-dire pas simplement les expériences elles-mêmes, mais aussi les conditions qui ont favorisé leur venue et qui les ont porté.
Sans la mémoire, il n’y a aucune forme de vie possible, car les structures mêmes de la vie fonctionnent sur une mémoire biologique.
Et au niveau mental, la mémoire représente un aspect fondamental de notre vie qui refuse de disparaître. Être est ce qui perdure, dans le temps et dans le devenir. Sans que nous nous en rendions compte, elle est une nourriture pour notre structuration quotidienne.
Pour l’ÂYURVEDA sa source subtile se trouve dans le cœur. Plus on aime, plus on retient (cf. « apprendre par cœur »).
La condition humaine est tissée de mémoire.
Tout ce que nous avons vécu, notre environnement familial, notre nourriture, les gens que nous avons rencontrés, notre éducation, nos lectures, les langues que nous avons apprises, les films que nous avons vus, les histoires des uns, des autres, bref, tout ce qui forge une histoire et une culture, personnelle ou collective, tout ce qui fait l’épaisseur, la couleur, la richesse d’une vie, tout cela s’appuie sur la mémoire.
La mémoire imprègne toutes les composantes de notre intériorité, émotionnelles, affectives, mentales, et aussi, bien sûr, les idées justes, les fausses, l’imagination, le sommeil et les rêves dont nous parle Patanjali.
Mais elle est sélective, elle est filtrée par le désir (désir de ne retenir que ce qui nous plaît ou nous déplaît) et par l’inconscient qui, avec ses censures, ses leurres et ses masques, la modèle et la transforme.
Nous traînons tous notre passé comme on traîne derrière soi un sac rempli de cailloux. Nous sommes en permanence alourdis par les souvenirs de tout ce que nous avons vécu. Nous nous asphyxions, nous nous empoisonnons à ressasser, à remâcher les vieilles rancunes, les vieilles douleurs, les regrets, les souvenirs, heureux ou malheureux. Tout cela forme un écran voilant nos perceptions.
Comme pour les rêves qui imprègnent notre vie diurne, nos souvenirs nous empêchent d’être neufs, brouillant en permanence l’espace de notre liberté quotidienne. Au lieu d’être disponibles et de nous ouvrir à l’ici et maintenant, nous restons de vieilles antiquités poussiéreuses.
Nos conditionnements, nos imprégnations subconscientes (les SAMSKARA) et les « parfums du passé » (les VÂSANA), sont tissés de mémoire. Pour Patanjali, le lien puissant qu’il y a entre mémoire, conditionnements et pulsions inconscientes représente un obstacle majeur pour l’établissement durable de la Pleine Conscience (Y .S.IV,8, 9, 10).
Mais, quand les fluctuations mentales dues à nos conditionnements s’interrompent un court instant, grâce à NIRODHA PARINÂMA (2), s’ouvre alors une première porte pour les transformations profondes (Y.S. III,9).
La mémoire est pourtant indispensable pour tout progrès. La capacité de nous rappeler avec justesse et clarté les expériences vécues, par nous-même ou par d’autres, de les re-tenir pour en tirer des leçons, est le fondement de VIVEKA, le discernement, et ce à tous les niveaux, individuels ou collectifs. Elle est un moteur d’évolution et de renouveau, car elle nous permet d’analyser et de comprendre les facteurs qui ont favorisé et nourri telle ou telle expérience, les positives, bien sûr, mais surtout les négatives, les ravageuses, les destructrices. Ainsi, avec la ferme volonté du « plus jamais ça ! », pourrons-nous éradiquer toute possibilité de formation et de retour de ces mêmes expériences.
Elle est aussi une des composantes qui vont nous permettre, pour Patanjali, d’accéder à SAMÂDHI, la Pleine Conscience ( « (d’autres) atteignent la sagesse du SAMÂDHI grâce à la foi, une puissante volonté, et à la mémoire » Y.S. I,20)
Observons ce qui se passe quand la mémoire se dégrade, comme dans la maladie d’Alzheimer. Tous les apprentissages se défont en ordre inverse de leur acquisition. Ce retour vers la conscience embryonnaire et la vulnérabilité du nouveau-né de la part de personnes adultes est insupportable pour les observateurs. Tout ce qui fait l’épaisseur d’une vie d’homme, construite, élaborée, complexe, riche en savoirs, intelligence et amour s’efface progressivement. Si l’on pense que le chemin d’une vie va dans une direction d’accomplissement, de transmission d’expérience, et d’une certaine sagesse, là, nous sommes directement confrontés à l’absurde existentiel, à un bilan négatif, stérile et inutile.
La fuite de la mémoire est un vrai naufrage .
POUR CONCLURE.
Les mouvements, les agitations permanentes de notre mental, occultent, pour Patanjali, cette conscience-témoin, DRASHTAR, qui se trouve au plus profond de chacun d’entre nous.
Qu’a-t-il voulu nous dire dès le début du premier chapitre, en citant ces cinq structures du mental ?
Il les a sélectionné pour leur complexité, leur puissance et leur ambiguïté. Car ces cinq structures sont premières dans ce qui fonde l’humain :
pas d’homme sans appréhension ni représentation cognitives du monde, celui du dehors et celui du dedans,
pas d’homme sans fonction imaginative,
pas d’homme sans sommeil ni sans rêves,
et surtout, pas d’homme sans mémoire.
Le grand défi, pour celui qui désire faire émerger cette conscience regardante profonde, conscience colorée par les mouvements du mental, surtout par ceux que nous venons de citer, c’est justement en avoir une connaissance extrêmement précise, la plus claire et intelligente possible, pour savoir en situer exactement les champs d’action afin de pouvoir ouvrir un autre espace. Alors, cette composante conscience-profonde, subtile, claire et absolue, une fois dévoilée, rayonnera dans sa réalité.
Tout de suite, Patanjali entrera dans le concret et nous proposera une première solution pour suspendre ces mouvements :
(I,12) « abhyâsa vairâgyâbhyâm tân nirodhah » : Leur suspension (s’obtient grâce à) une pratique persévérante et un esprit de non-attachement
Il développera ce premier « outil technique » sur quelques sûtra.
Mais cela demande une étude un peu plus approfondie que nous nous proposons d’aborder ultérieurement.
Notes :
(1) des trois modalités de l’énergie : RAJAS, TAMAS et SATTVA, TAMAS est l’énergie de pesanteur, d’opacité, d’obscurcissement, RAJAS étant l’énergie de dynamisme, d’expansion, de mobilité, et SATTVA celle d’équilibre, de légèreté, d’intelligence et de lumière.
(2) Le tout début du troisième chapitre (VIBHÛTI PÂDA) clôture le parcours des membres du yoga, avec la concentration (DHÂRÂNA), la méditation (DHYÂNA), et la Pleine Conscience (SAMÂDHI). A ce moment-là, resplendit, par-delà les formes, la totalité du sens (III, 1, 2, 3). Patanjali englobe ces trois « membres » sous le nom de SAMYAMA, la totale maîtrise, d’où va jaillir la lumière de la connaissance (Y.S. III, 4, 5), et ce dans tous les domaines.
Si l’on maintient SAMYAMA, la qualité de la Pleine Conscience évoluera, amenant les PARINÂMA, les « maturations », les « transformations ».
NIRODHA PARINÂMA sont les transformations profondes générées par la suspension des conditionnements et des imprégnations inconscientes (SAMSKARA) et par l’arrêt de leur impact sur le mental. C’est la première porte ouvrant sur des transformations majeures.
Suivront ensuite d’autres PARINÂMA (SAMÂDHI P., EKÂGRÂTA P.) qui ouvriront, à leur tour, d’autres portes permettant d ‘expérimenter les possibilités élargies (VIBHÛTI).
Marguerite Aflallo, Cinq modalités du mental (deuxième partie), 2014.
